Nos dossiers & Partenaires

Don du corps à la science : « C’est une victoire sur la mort »
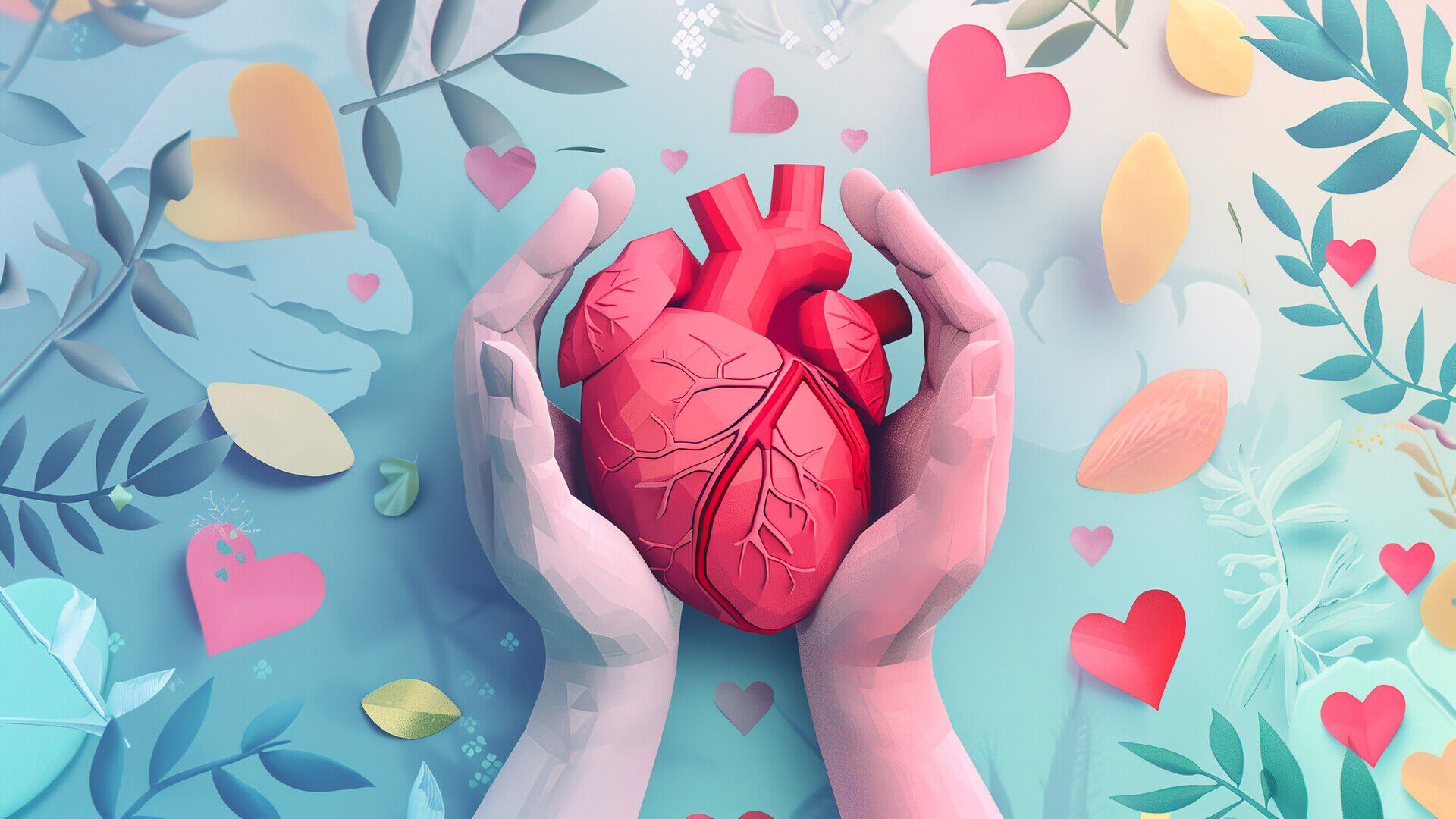
En Belgique, le don d’organes est automatique (sauf opposition), mais offrir son corps à la science exige par contre une démarche volontaire et anticipée. Sans inscription préalable, impossible de faire ce dernier geste au service de la recherche.
Si le don d’organes est relativement connu du grand public, le don de corps à la science à des fins d’enseignement et de recherche, l’est beaucoup moins. Pourtant, il constitue un élément fondamental de la formation des futurs médecins et du perfectionnement des chirurgiens, rappelle Pierre Garin, directeur du laboratoire d’anatomie de la faculté de médecine de Namur. Et qui dit don, dit évidemment gratuité : ni le donneur ni sa famille ne reçoivent de contrepartie financière.
Si tout Belge est présumé donneur d’organes (sauf opposition), en revanche le don de corps à la science nécessite une démarche volontaire et proactive de la part du donateur. « Il est donc impératif d’anticiper cette décision et d’effectuer les formalités requises avant son décès », insiste Pierre Garin.
« Malheureusement, ça nous arrive encore régulièrement d’avoir des familles qui nous téléphonent en nous disant que leur proche est décédé et qu’il voulait donner son corps à la science. Mais, c’est trop tard à ce moment-là. S’il n’avait fait aucune démarche, c’est interdit pour nous d’accepter le corps. » Par ailleurs, pas question d’offrir le corps de quelqu’un d’autre. « Seule la personne concernée peut faire don de son corps. Vous ne pouvez donc pas décider à sa place, par exemple pour votre mère atteinte d’Alzheimer, si elle n’est plus en mesure de donner son consentement. »
Comment faire don de son corps à la science ?
Alors, comment faire ? Le processus est relativement simple : il suffit de contacter la faculté de médecine à laquelle vous désirez donner votre corps et de remplir un formulaire officiel. « La plupart du temps, les gens choisissent une université parce qu’eux ou leurs enfants y ont fait leurs études ou bien parce qu’ils habitent la région. Mais c’est un choix tout à fait libre et personnel. Si vous désirez faire don de votre corps à Namur, il suffit de nous téléphoner et de nous envoyer un e-mail, on explique ensuite tout le processus de don et, si la personne est toujours motivée, on lui envoie un formulaire, qui doit être rempli, signé et renvoyé. »
Ce document, qui a la valeur d’un testament, permet au donateur de préciser ses souhaits quant au devenir de son corps après utilisation. Selon l’université, deux options s’ouvrent à lui : un retour auprès de sa famille ou une inhumation anonyme organisée par l’université. Attention, chaque université a son processus propre.
« À l’université de Namur, dans le premier cas de figure, la famille choisit elle-même l’entreprise de pompes funèbres et organise les funérailles selon les choix du défunt - comme dans un processus classique - et les frais de funérailles sont à la charge de la succession. Dans le second cas de figure, l’université et la Ville de Namur offrent gratuitement une concession de cinq ans dans un des cimetières de la ville de Namur. Dans ce cas, l’inhumation du corps est faite en l’absence de la famille, qui est contactée par la suite - si le défunt en a fait la demande. »
Attention, une fois les informations validées, seules les modifications demandées directement par le donateur auprès de l’université seront acceptées. « Mais on peut à tout moment changer d’avis ou changer telle ou telle disposition. » Le donateur reçoit une copie de l’exemplaire et une carte à porter sur soi, attestant du legs du corps à la faculté sélectionnée.
Parlez-en à vos proches
« Il est crucial d’en parler à ses proches, insiste Pierre Garin. Le donateur doit impérativement informer ses proches de son choix, car c’est à eux qu’il revient de nous contacter au moment du décès. Ce n’est ni à la Commune ni à l’hôpital de le faire, mais bien à la famille. Si elle ne le fait pas, nous ne sommes pas informés et le don ne peut donc pas avoir lieu. » Un nombre significatif de déclarations de don ne sont pas honorées. C’est que cette étape est souvent délicate, puisqu’elle confronte les proches à une décision difficile à un moment de deuil - car qui dit don du corps, dit funérailles différées.
Que se passe-t-il au moment du décès ?
Au moment du décès, la famille du défunt doit donc contacter l’université et, selon les directives de celle-ci, prendre contact avec les pompes funèbres. « À Namur, le corps sera pris en charge par l’entrepreneur en pompes funèbres mandaté par l’université. » La dépouille doit être transférée au laboratoire le plus rapidement possible, au maximum dans un délai de 48 heures. « Il est essentiel d’embaumer rapidement le corps pour son usage scientifique, car les phénomènes post mortem peuvent le rendre inutilisable. Cela signifie que la famille dispose de peu de temps avant la prise en charge par les pompes funèbres »
L’université conserve le corps pendant la durée des recherches, qui peut varier de quelques semaines à deux ou trois ans selon les établissements. Ensuite, il est soit restitué à la famille, soit inhumé par l’université.
Un don au service de l’enseignement et de la recherche
Le don de corps est avant tout un outil pédagogique pour les étudiants en médecine. Ces derniers, après avoir acquis des connaissances théoriques, doivent impérativement se confronter à la réalité anatomique, souligne notre expert.
« Cela leur permet d’appréhender l’anatomie de façon concrète, de s’exercer à des gestes techniques en surmontant le stress, la peur et l’émotion face à un défunt. Un certain nombre de ces jeunes gens n’ont jamais été confrontés à la mort dans leur propre famille. Cela suscite toutes sortes d’émotions et de questions et cela fait partie de leur formation. Quant à l’aspect technique, cela leur permet de voir l’anatomie en vrai : rien ne vaut la réalité pour avoir une perception concrète et pouvoir s’entraîner à des points de suture et autres choses très basiques que n’importe quel médecin doit être capable de faire. »
Mais l’utilisation des corps ne s’arrête pas à la formation des futurs médecins. Elle est également essentielle au perfectionnement des chirurgiens en exercice. « Nous recevons des spécialistes qui viennent tester de nouvelles techniques ou s’entraîner à l’utilisation de nouveaux instruments médicaux », souligne Pierre Garin. Grâce à ces dons, des avancées majeures ont pu être réalisées.
Un choix encore rare en Belgique
De nombreuses universités belges manquent de corps pour la formation et la recherche. Bien que la procédure soit accessible à tous, le nombre de personnes optant pour cette démarche reste marginal. « Il n’y a aucune limite d’âge ni de condition de santé particulière », rappelle Pierre Garin. Seuls les décès liés à des causes suspectes, le prélèvement des organes ou des accidents graves peuvent entraîner un refus pour des raisons techniques.
Chaque année, la faculté de médecine de Namur organise une cérémonie d’hommage aux donateurs. « Nous tenons à exprimer notre reconnaissance à ces personnes et à leurs familles. » Les étudiants, qui bénéficient directement de ces dons, participent activement à cet hommage.
Un dernier acte de générosité
Les motivations des donateurs varient, mais une constante revient dans leurs témoignages : l’envie de rester utile après la mort. « Certains souhaitent exprimer leur gratitude envers le corps médical, après avoir bénéficié de soins de qualité. D’autres veulent rendre hommage à leur université… Beaucoup voient cela comme une victoire sur la mort, confie Pierre Garin. C’est une manière de continuer à servir la science et la médecine, même après leur disparition. »
Comment se déroule une cérémonie d’adieux sans la présence du défunt ?
Comment dire au revoir à un proche lorsque son corps a été donné à la science ? Et si on réinventait les rituels d’adieu ?
Le deuil suit généralement un schéma bien ancré en Wallonie : des visites, une veillée, une cérémonie, puis une inhumation ou une crémation. Mais que se passe-t-il lorsque le défunt a choisi de faire don de son corps à la science ?
Un temps de recueillement réduit, mais possible
Lorsque le corps est légué à une faculté de médecine, il doit être pris en charge rapidement, dans les 48 heures suivant le décès. « Le plus tôt est le mieux - 72 heures, grand maximum selon l’université. Cela veut dire que le corps ne sera pas présent au funérarium pour les visites ni pour la cérémonie. Ce n’est pas facile car l’endeuillé a besoin de ce temps de transition vers la séparation définitive. ‘Il est mort, mais je peux encore le voir, lui parler, comme s’il m’entendait.’» Cette contrainte peut intensifier le choc pour les proches, si la décision n’a pas été anticipée en famille, souligne Amélie Javaux, psychologue clinicienne spécialisée dans le deuil, fondatrice et coordinatrice de la clinique du deuil au CHR de la Citadelle, à Liège. Elle rappelle que la période de veille du corps avant son départ final et les rituels sont ancrés dans de nombreuses cultures depuis les hommes de Cro-Magnon.
Des rituels à réinventer
Lors d’un don du corps, l’incinération ou l’enterrement est reporté à plusieurs semaines voire plusieurs années. Mais cela ne veut pas dire que la cérémonie ne peut pas avoir lieu. Le deuil n’a pas de règles immuables, et l’absence de corps ne signifie pas l’absence de cérémonie, rappelle notre experte. « La famille peut organiser un moment de recueillement, avec ou sans cercueil symbolique, suggère Amélie Javaux. Un espace de mémoire avec des photos et des souvenirs peut aider, il faut se montrer créatif. Les rituels peuvent se réinventer. L’essentiel est d’honorer la mémoire du défunt et de lui dire au revoir à sa manière, entouré des gens qu’on aime. »
Aujourd’hui, on voit également se déployer toute une série de mémoriaux et de sites mémoriels en ligne. Les réseaux sociaux, habituellement dédiés au partage du quotidien, peuvent se transformer en des lieux de mémoire où proches et amis se rassemblent pour rendre hommage aux disparus.
Légende photo : Si le défunt n’a jamais évoqué son souhait de donner son corps à la science, le choc pour la famille peut être violent.
Caroline Beauvois
